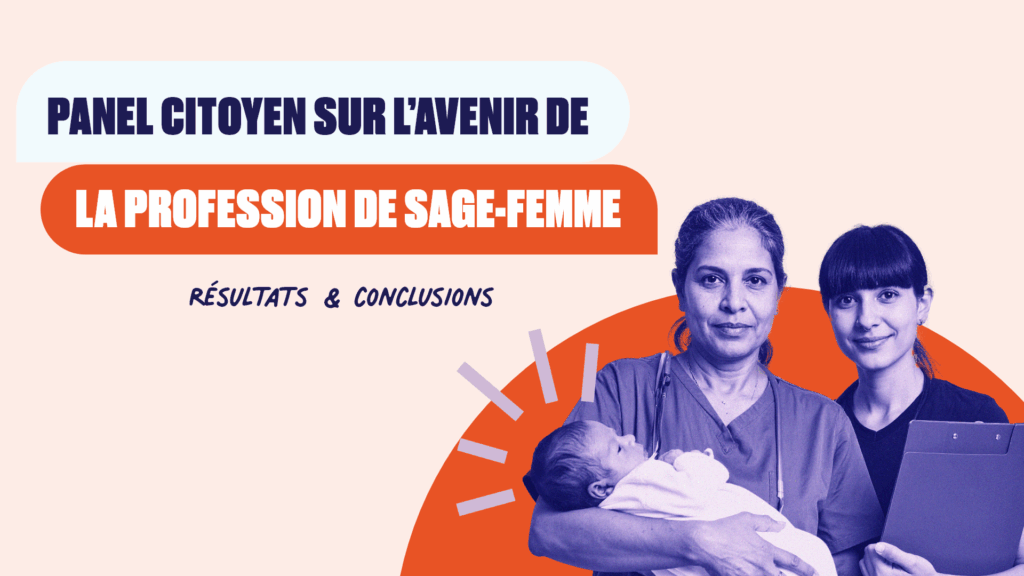Cette année, le Québec a lancé l’une des plus vastes consultations publiques sur l’accouchement et la profession de sage-femme depuis la légalisation de cette pratique en 1999. Ces efforts, menés par l’Institut du Nouveau Monde (INM), arrivent à un moment crucial : malgré un intérêt grandissant du public, l’accès aux services demeure inégal d’une région à l’autre.
Financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, trois initiatives majeures ont structuré cette consultation réalisée par l’Institut du Nouveau-Monde : un panel de citoyen·nes formé de résident·es sélectionnés aléatoirement, une enquête auprès de familles utilisatrices ou connaissant les services de sage-femme, ainsi qu’une enquête auprès des sages-femmes, incluant les étudiantes et d’anciennes praticiennes. Ces perspectives croisées révèlent à la fois des priorités partagées et des lacunes majeures.
Ces résultats confirment des préoccupations exprimées depuis longtemps, tout en lançant un appel à l’action pressant. Nous nous sommes entretenus avec Sarah Landry, coordonnatrice générale du Mouvement pour l’autonomie dans l’enfantement, pour analyser ces données et examiner les pistes de changement à privilégier.
Les familles font l’éloge des sages-femmes (et en réclament davantage)
Les données recueillies révèlent un niveau de satisfaction exceptionnellement élevé envers les services de sage-femme. Plus de 90 % des familles se déclarent très satisfaites des soins reçus, tandis que 93,8 % recommanderaient ces services à leur entourage.
Sarah explique : « Les qualités les plus appréciées sont l’approche chaleureuse et bienveillante, le respect de la physiologie et de l’autonomie, la continuité des soins ainsi que le sentiment de sécurité que procurent les maisons de naissance. »
Les maisons de naissance ressortent comme des lieux où les familles se sentent particulièrement en sécurité et soutenues, une expérience qui tranche grandement avec celle vécue en milieu hospitalier. Les répondant·e·s ont également souligné l’importance des visites à domicile et de la participation des partenaires et des frères et sœurs au parcours périnatal, créant ainsi un véritable sentiment de communauté autour de la naissance.
L’enjeu crucial de l’accessibilité
Malgré ce taux de satisfaction remarquable, l’accès aux services de sage-femme demeure un enjeu majeur. Au Québec, les sages-femmes n’accompagnent qu’environ 8 % des grossesses. Les familles se heurtent souvent à des listes d’attente, à de longues distances à parcourir ou à l’absence totale de services dans leur région. Selon Sarah, les enquêtes « révèlent des inégalités profondes ». De plus, le Mouvement sait que les groupes en régions éloignées des grands centres demandent des chambres de naissance et des lieux appropriés à leurs grands territoires.
L’enquête révèle que 12,5 % des répondants parcourent en moyenne 1,5 heure pour accéder aux soins, certains devant effectuer jusqu’à six heures de trajet. Des régions entières, comme Laval et la Côte-Nord, sont quant à elles totalement dépourvues de sages-femmes.
Le manque de visibilité de la profession se manifeste notamment dans la façon dont les gens découvrent les services. Sarah rapporte que selon le sondage, « 52 % des utilisatrices ont découvert la pratique sage-femme par le bouche-à-oreille ».
Ce que les données démontrent
Bien que les enquêtes aient été menées auprès de groupes variés (citoyens, familles et sages-femmes), leurs conclusions convergent de manière significative. Dans les trois enquêtes, les participants ont mis en évidence le besoin d’un meilleur accès, d’une meilleure compréhension du public et d’un engagement envers les principes directeurs de la profession de sage-femme.
« Trois thèmes reviennent de façon récurrente », explique Sarah. « L’accessibilité : les familles, les sages-femmes et la population générale réclament davantage de services dans l’ensemble des régions, ainsi qu’une meilleure accessibilité pour les femmes les plus vulnérables. La visibilité et la reconnaissance : la pratique demeure largement méconnue et les mythes persistent, y compris au sein du milieu médical. La philosophie de la pratique : la continuité, l’autonomie décisionnelle et le respect de la physiologie constituent les fondements à préserver dans le développement futur de la pratique. »
Elle ajoute que le panel de citoyens « résume parfaitement ce consensus en proposant que les sages-femmes deviennent la porte d’entrée des soins périnataux au Québec, afin de répondre à la majorité des besoins de première ligne ». Pour y parvenir, il faudrait toutefois « augmenter le nombre de sages-femmes et développer assez de lieux de naissance sur l’ensemble du territoire du Québec ».
Les sages-femmes tirent la sonnette d’alarme sur la médicalisation
Le processus de consultation a également révélé une tension croissante au sein de la profession de sage-femme. Si les praticiennes demeurent attachées à la philosophie de leur travail, nombreuses sont celles qui s’inquiètent de la transition massive vers des soins médicalisés.
Sarah met en lumière les résultats de l’enquête, qui indiquent que « plus de 30 % des sages-femmes jugent “difficile” de respecter le processus physiologique » et que « 25 % éprouvent des difficultés à soutenir l’autonomie et le pouvoir des femmes, dans les décisions relatives aux soins ».
Elle explique que cela découle de la pression d’expliquer de plus en plus de tests, d’examens ou de possibilités’ : « Plusieurs sages-femmes affirment se sentir en infériorité sur le plan professionnel et dénoncent la pression qu’elles subissent pour se conformer aux décisions des équipes médicales, même lorsque ceux-ci entrent en contradiction avec les choix des familles. »
Cette préoccupation ne concerne pas uniquement les praticiennes, poursuit Sarah : « De nombreuses familles nous font part depuis plusieurs mois (…) qu’elles perçoivent elles aussi une perte d’autonomie dans leurs soins et s’inquiètent de voir l’approche des sages-femmes se rapprocher des normes hospitalières. »
D’ailleurs, elle fait remarquer qu’en début d’année, « un groupe de citoyen.nes s’est réuni spécifiquement pour réfléchir à la médicalisation de la profession de sage-femme et chercher des solutions collectivement. Cette réunion confirme que les professionnel·les et les utilisateur·trice·s partagent cette préoccupation, qui mérite d’être discutée et approfondie lors du Grand sommet des états généraux de la pratique sage-femme. »
L’accès et le soutien doivent aller de pair
Malgré un consensus sur les objectifs généraux, les familles et les sages-femmes ont exprimé des préoccupations divergentes à court terme. « Les familles et les citoyens mettent l’accent sur l’accès et l’information, notamment le manque de compréhension de la pratique elle-même », explique Sarah. « Tandis que les sages-femmes soulignent leurs conditions de travail : surcharge, longues heures de garde et manque de reconnaissance interprofessionnelle. » Elles présentent l’élargissement du champ de pratique des sages-femmes comme une solution à l’accessibilité, alors que c’est aussi une solution de flexibilité pour les conditions de travail.
Loin d’être contradictoires, ces différences mettent en évidence la nécessité de changements à court terme. « Ces divergences ne sont pas contradictoires », affirme Sarah. « Elles démontrent qu’il faut à la fois augmenter l’offre dans l’ensemble des régions du Québec et améliorer les conditions de travail pour retenir les sages-femmes. Il faut également sensibiliser le public aux avantages des soins prodigués par celles-ci et élargir le champ de pratique pour limiter certains transferts de soins. »
Les données ont aussi révélé que les obstacles aux soins prodigués par les sages-femmes ne sont pas seulement pratiques, mais également systémiques. « Les résultats mettent en lumière une double injustice », note Sarah. « Territoriale : l’accès dépend du code postal. Certaines familles ont une maison de naissance à proximité, tandis que d’autres doivent parcourir plusieurs heures de route pour s’y rendre ou y renoncer complètement. Structurelle : le paradigme médical demeure prévalent. Les sages-femmes font état de pressions pour se conformer aux décisions prises par d’autres professionnels ce qui limite leur autonomie clinique et l’application de leurs principes. » De plus, leur champ de pratique est limité, en partie à la suite de concessions faites dans les années 1990 pour réaliser la légalisation de la pratique sage-femme.
Elle ajoute que le panel citoyen « affirme clairement que les sages-femmes sont méconnues, y compris au sein du système de santé », et que ce manque de reconnaissance est « alimenté par des mythes et une faible présence médiatique ». En somme, « le droit de choisir le lieu et le modèle de soins demeure théorique pour de nombreuses personnes enceintes».
Aller de l’avant : une vision en phase avec le Mouvement
Les résultats de ces consultations seront directement transmises aux États généraux de la pratique sage-femme, un sommet provincial prévu pour l’automne 2025. « L’objectif de ce grand sommet est d’adopter des recommandations qui seront adressées à divers organismes, notamment le gouvernement québécois, l’Ordre des sages-femmes du Québec, les ministres de la Santé et de l’Enseignement supérieur, etc. », explique Sarah.
Les membres de la communauté, les professionnel·les et les familles joueront tous un rôle dans l’élaboration de ces recommandations. « Nous devons réfléchir ensemble à des recommandations susceptibles de mener à une augmentation de l’offre de services de sage-femme, à une multiplication des lieux d’accouchement et à une diversification des utilisateurs des services de sages-femmes », poursuit-elle.
Le Mouvement pour l’autonomie dans l’enfantement voit ces résultats comme une validation du travail qu’il accomplit depuis des années. « Ces résultats confirment la mission fondamentale du Mouvement », affirme Sarah. « Chaque femme et chaque personne enceintes a le droit de choisir son professionnel ainsi que son lieu d’accouchement. »
Alors que les consultations se terminent et que la phase suivante s’amorce, Sarah rappelle aux familles, aux sages-femmes et aux défenseurs des droits périnataux que leurs voix sont entendues et se reflètent dans les données : « Le message est clair : vous n’êtes pas seuls à revendiquer la liberté de choix, l’autonomie et le respect. Les données le confirment : la profession de sage-femme est appréciée et sécuritaire. Elle demeure largement méconnue et devrait être mieux comprise, afin que chacun puisse faire ses propres choix éclairés. »
L’objectif est sans équivoque : « Ensemble, familles, sages-femmes et allié·es doivent transformer ce consensus social en décisions politiques concrètes : ouvrir de nouveaux lieux d’accouchement adaptés aux réalités des régions éloignées ; former et retenir davantage de sages-femmes. » Sarah conclut ainsi : « Parce que donner naissance où on le souhaite et avec les personnes de son choix, n’est pas un privilège. C’est un choix de société que nous devons nous offrir. »
Le Sommet des États-généraux de la pratique sage-femme aura lieu les 29 et 30 novembre 2025 à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Si vous souhaitez y participer en amont ou en personne et donner votre avis pour l’avenir de la pratique sage-femme au Québec, faites le nous savoir en remplissant ce formulaire.